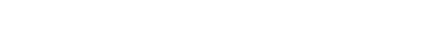Vente judiciaire MOA
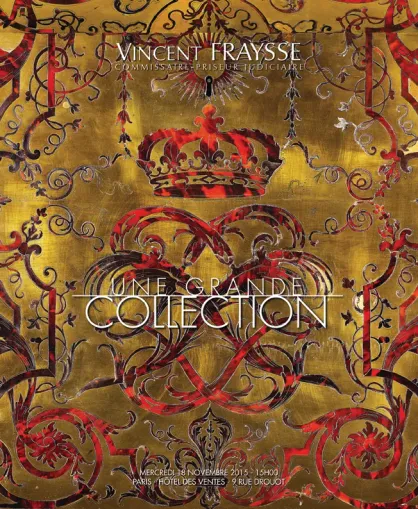
18 novembre2015
Heure15:00
LieuHÔTEL DES VENTES - 9 RUE DROUOT - PARIS - SALLE 9
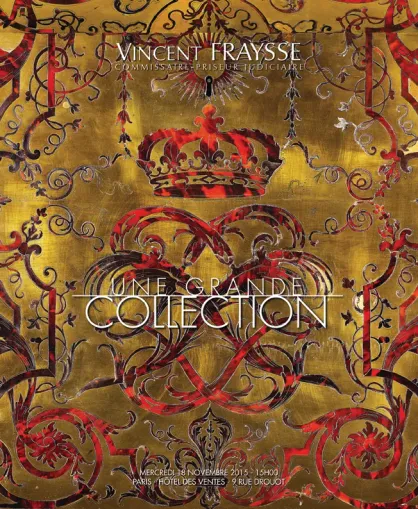
UNE GRANDE COLLECTION III.
TABLEAU ANCIEN
TABLEAUX MODERNES
IMPORTANTES PIERRES PRÉCIEUSES
MONTRES ANCIENNES
ORFÈVRERIE XVIE XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
HAUTE EPOQUE
ARCHEOLOGIE
OBJETS D’ART ET DE TRÈS BEL AMEUBLEMENT
TAPISSERIES DU XVIE SIÈCLE
Exposition

Lot 96
Paire de cuillères à ragoût en argent, modèle à filets. Gravées postérieurement d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
Poinçon du maître orfèvre Nicolas Gonthier, reçu en 1768.
Paris, 1784.
Longueur : 32 cm - Poids : 373 g
600 € - 1 000 €

Lot 97
Paire de flambeaux en argent, posant sur un pied rond à contours et moulures d’oves, la doucine et la cuvette ornées de filets enrubannés, l’ombilic ciselé de cartouches et coquilles sur fond amati, le fût triangulaire à pans, ciselé de coquilles, culots feuillagés, et de mascarons, le binet circulaire à moulures de filets enrubannés à base piriforme spiralée.
Poinçon du maître orfèvre François Forfelier, reçu en 1733.
Paris, 1737.
Hauteur : 26 cm - Poids brut : 1 697 g
Bibliographie :
Voir modèle similaire par François Belprey dans le catalogue de l’exposition Three Centuries of French Domestic Silver Its makers and its marks, Faith Dennis, Metropolitan Museum of Art, New-York 1960, n° 48, vol I, p. 60.
15 000 € - 25 000 €

Lot 98
Plat à ragoût en argent, de forme ronde, creux, à contours, la bordure à moulures de filets et godrons, les anses mouvementées et agrafées de cannelures. Gravé sur le marli d’armoiries partiellement effacées.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Jean Delande.
Bayonne, vers 1737.
Diamètre : 36,6 cm - Longueur aux anses : 40,5 cm - Poids : 1 634 g
Provenance :
Vente 26 avril 1988, Maîtres Couturier - Nicolay.
15 000 € - 25 000 €

Lot 99
Écuelle, son couvercle et son présentoir en argent, les bordures à moulures de filets enrubannés et agrafes, le corps uni, les oreilles mouvementées ornées d’enroulements et rocailles, le couvercle à doucine, ciselé au repoussé de guirlandes de fleurs feuillagées, le fretel en forme de rose en bouton sur une terrasse de feuilles. Le présentoir à contours. Gravés d’armoiries ou d’initiales surmontées d’une couronne de marquis (petites bosses).
Poinçon du maître orfèvre Honoré Burel, reçu en 1748.
Aix-en-Provence, 177(7) ?
Pas de poinçon de décharge sur la graine et le couvercle.
Dans son écrin en basane noire.
Hauteur : 13 cm - Longueur aux anses : 30 cm - Diamètre du présentoir : 26,6 cm - Poids : 1 660 g
Provenance :
Vente Maître Anaf, Lyon, 10 mars 1989,* n° 24.
6 000 € - 12 000 €

Lot 100
Quatre coquetiers en argent, leur intérieur en vermeil et argent, en forme de panier cintré et tressé.
Poinçon du maître orfèvre Pierre-François Rigal, reçu en 1770.
Pour un, Paris, 1773.
Pour un, Paris, 1774.
Pour deux, la lettre date effacée, Paris, 1770-1774.
Hauteur : 3,3 cm - Poids brut : 159 g
Le vermeil postérieur.
1 500 € - 2 500 €

Lot 101
Exceptionnel candélabre en argent
provenant de la Chancellerie d ’Orléans
Paris 1783
Poinçon du Maître Orfèvre Jean-Ange Loque (?-ap.1831) Paris 1782-1783.
Signé sur la base Loque Fecit.
Dans son étui à âme de bois recouverte de maroquin rouge frappé de lis et de motifs dorés au petit fer.
Inscription effacée et plusieurs étiquettes sur l’écrin en cuir : Etat N°5 Girandoles à 4 branches avec bobèches Pesant 3… 39… et N°121 1 flambeau d’argent à 4 lumières. Etui de maroquin rouge.
Une plaque en cuivre avec le numéro 3 découpé, appliquée sur la base de l’écrin et l’inscription Grande Chancellerie en noir sur le fût de celui-ci.
Argent ciselé, gravé.
Hauteur fermée : 47,3 cm - Hauteur en position maximale : 56,5 cm - Poids brut : 3 500 g
Provenance :
Hôtel de Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson, marquis de Voyer (1722-1782), dit La Chancellerie d’Orléans, rue des Bons-Enfants, à Paris.
Ancienne collection Camille Plantevignes.
Bibliographie :
Reproduits dans le catalogue de l’exposition Three Centuries of French Domestic Silver Its makers and its marks, Faith Dennis, Metropolitan Museum of Art, New-York 1960, n°231, p. 162.
Reposant sur une base circulaire moulurée et soulignée d’une frise de palmettes d’acanthe, notre candélabre présente un ombilic alternant des feuilles et des chutes aussi d’acanthe, ceint en sa partie supérieure par un enfilement de perles et surmonté par un nœud composé de registres successifs de feuilles lancéolées, d’un tore de laurier et d’un collier torsadé, alternant avec des parties lisses. Le fût, cannelé et rudenté d’asperges, comporte un chapiteau d’ordre ionique dont l’échine est rythmée par des feuilles d’eau et l’abaque à volutes et oves est ponctuée sur chaque face par des fleurons d’acanthe. Deux cartouches ovales suspendus à un nœud de rubans accroché à une patère ornent la partie supérieure du fût et sont réunis par des chutes de lauriers disposées en guirlandes. Une ample bobèche décorée de feuilles lancéolées alternant avec doubles fleurons d’acanthe et soulignée par un motif torsadé, supporte quatre binets cannelés et rudentés d’acanthe, eux aussi ornés de motifs de perles enfilées et de torsades, disposés autour d’un élément central monté sur un piédouche dont le corps torsadé, souligné à la base de palmettes d’acanthe, rappelle la forme d’une pomme de pin. Un système de poussoir à ressort permet de régler la hauteur de l’éclairage à la demande.
Le candélabre conserve son étui dont l’âme de bois est recouverte en maroquin rouge parsemé de fleurs de lis et souligné de motifs au petit fer, le tout doré. Muni de trois verrous métalliques, l’étui présente sur la base une étiquette de laiton portant le chiffre 3 découpé.
Ainsi que l’inscription figurant sur l’écrin l’atteste, notre candélabre provient de la Chancellerie d’Orléans, appellation donnée à l’hôtel d’Argenson situé à Paris, rue des Bons-Enfants, à l’emplacement des actuels n°19 et n°10, rue de Valois1, à cause de la charge de chancelier du duc d’Orléans exercée successivement par Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson (1696-1764), puis par son fils, Marc-René, marquis de Voyer (1722-1782) entre 1723 et 1782. Elevée par l’architecte Germain Boffrand vers 1704-1705, à l’emplacement de l’ancien hôtel de la Roche-Guyon, et ouvrant sur les jardins du Palais Royal, dont Philippe d’Orléans, futur Régent du royaume devint propriétaire en 1702, la nue-propriété de la nouvelle bâtisse fut cédée par ce dernier à sa maîtresse, Marie-Louise-Madeleine-Victoire Lebel de La Boissière de Séry, comtesse d’Argenton, qui l’occupa jusqu’à sa disgrâce, en 1710. Cédé l’année suivante à la veuve du prince de Montauban, l’hôtel fut racheté par le Régent en 1720 et échut à son fils, Louis Ier d’Orléans « le Pieux » (1703-1752), qui en céda l’usufruit en 1725, à son chancelier, chef du conseil et surintendant de ses finances, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson. A la mort de Louis Ier d’Orléans, son fils, Louis-Philippe, dit « le Gros » (1725-1785), rendit le 23 juin 1752 l’usufruit de l’hôtel à Marc-René de Voyer de Paumly d’Argenson, marquis de Voyer, qui héritait aussi la charge de chancelier du duc d’Orléans. Conservé dans la famille Voyer de Paulmy jusqu’en 1784, lorsqu’il fut repris par les Orléans, l’hôtel fut séparé alors des jardins du Palais Royal par l’ouverture de la rue de Valois. Vendu à la Révolution comme bien national, l’hôtel fut surélevé d’un étage au XIXe siècle, puis démoli en 1923, suite à un projet d’extension des locaux la Banque de France. Les décors, déposés par les soins de la Banque de France, nouvelle propriétaire des lieux, furent entreposés à Asnières, mais le projet de leur remontage de l’architecte Alphonse Defrasse fut brutalement arrêté par la crise de 1929, puis par la Seconde Guerre Mondiale.
Grand collectionneur d’art et mécène, le marquis de Voyer décida de mettre son hôtel à la nouvelle mode, qui était alors au goût grec, et confia les travaux à l’architecte Charles de Wailly (1730-1798), qui avait déjà donné en 1762 le modèle pour la colonne en porphyre et marbre blanc, entourée de termes en bronze par Auguste et Pajou2 pour l’ancienne galerie de cette demeure. A partir de 1763, Wailly remania le vestibule et la salle à manger, puis poursuivit avec les travaux du grand salon (1765-1769), de la petite salle à manger (1767-1769), transformés les deux à nouveau, respectivement en 1771 et 1772. Suivirent les décors de la chambre de la marquise de Voyer réalisés entre 1767 et 1770 dont les dorures furent terminées en 1771-1772. La transformation des intérieurs et des façades de l’hôtel était terminée en 1774, lorsque William Chambers en dessina quelques relevés, lors de son voyage à Paris3 (fig. a-b).
Sous la conduite de l’architecte Wailly, les meilleurs artistes de l’époque œuvrèrent pour la réalisation des nouveaux décors inspirés par le retour à l’Antique pour cet hôtel : les peintres Jean-Jacques Lagrenée le Jeune et Louis-Jacques Durameau4, le sculpteur Augustin Pajou, le bronzier Pierre Gouthière, les peintres décorateurs Bellangé, Guilliet et Deleuze, le menuisier Matthieu Bauve ou Debauve, etc.
Hélas, alors que l’inventaire après décès du marquis de Voyer du 5 octobre 17825 n’est pas accessible actuellement aux Archives nationales, celui de sa veuve, Jeanne-Marie-Constance de Mailly, dressé le 23 septembre 1783, ne consigne au chapitre de l’argenterie que « deux girandoles à trois branches et quatre flambeaux le tout d’argent poinçon de Paris pesant ensemble trente-cinq marcs une once deux gros, prisés à juste valeur et sans crue […] 1761 livres 18 sols 2 deniers6» . On se souvient qu’en 1784, l’hôtel d’Argenson retournait dans l’apanage des Orléans.
Cependant, l’inventaire après décès de Louis-Philippe d’Orléans, du 29 novembre 17857, ne consigne non plus la présence d’un luminaire en argent pouvant correspondre à l’exemplaire conservé. En revanche, sous le numéro 1831 sont répertoriées « douze girandolles ou candélabres à quatre lumières en cuivre argenté porté au mat avec douze coffrets ferrés et garnis en dedans de peau jaune par compartiments, prisés deux mille trois cent livres, cy 2 300 lt », dont, hormis les matériaux, la description ne manque pas d’évoquer notre candélabre.
Si l’activité de l’orfèvre Jean-Ange-Joseph Loque est mieux connue pour le XIXe siècle, l’histoire voulut nous faire parvenir son portrait gravé au XVIIIe siècle8, lorsqu’il était mentionné en 1792, rue de la Juiverie9, ainsi qu’une étiquette de son commerce10 à l’enseigne Au Ciboire d’Or, situé quai Le Pelletier, au numéro 42, datant des années 1806, lorsqu’il avait réorienté sa production essentiellement vers la vaisselle d’église, qu’il continua à fabriquer sous la Restauration et dont un nombre important de pièces est conservé (fig. c-d). Plus tard, entre 1827 et 1829, il participa à la campagne de remise en état des gemmes de la Couronne er réalisa pour le Louvre les pieds en argent doré de trois coupes, dont deux en sardoine et une en jaspe11.
1 Arnaud de Maurepas, Antoine Boulant, Les Ministres et leurs ministères du Siècle des Lumières 1715-1789. Etude et Dictionnaire, Paris, Christian/JAS, 1996, p. 190.
2 Londres, Wallace Collection, inv. F291.
3 Monique Mosser, Daiel Rabreau, Charles de Wailly peintre architecte dans l’Europe des Lumières, Paris, Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites, 1979, p. 44-45 ; voir aussi Noël Francoeur, L’hôtel de la chancellerie d’Orléans, ancien hôtel d’Argenson, du Palais-Royal au Marais, Paris, 1984.
4 Anne Leclair, « Les plafonds peints de l’hôtel d’Argenson : commande d’un amateur parisien (1767-1773), Gazette des Beaux-Arts, t. CXL, novembre 2002, p. 273-306.
5 Arch. nat., Min. cent., CXV, 930.
6 Arch. nat., Min. cent., CXV, 935.
7 Arch. nat., X1A 9181.
8 Paris, B.n.F., dépt. des Estampes et de la Photographie, coll. De Vinck, Réserve QB-370 (7)-FT 4.
9 Henry Nocq, Le Poinçon de Paris. Répertoire des maîtres-orfèvres de la juridiction de Paris depuis le Moyen-âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, vol. 3, Paris, 1928, p. 160-161.
10 Waddesdon. The Rothschild Collection, inv. 3686.3.61.133.
11 Inv. MR 125 ; MR 120 ; MR 184, voir Daniel Alcouffe, Les Gemmes de la Couronne, Paris, RMN, p. 24 et cat. nos 21, 94 et 185.
30 000 € - 60 000 €

Lot 102
Paire de plats ovales en argent, à contours et moulures de filets.
Travail de Wolfers, Bruxelles, titre (900/1000e).
Longueur : 54,8 cm - Poids brut : 2 639 g
800 € - 1 000 €

Lot 103
Paire de plats ronds en argent, à contours et moulures de filets.
Travail de Wolfers, Bruxelles, titre (900/1000e).
Diamètre : 43,3 cm - Poids brut : 2 867 g
500 € - 700 €

Lot 104
Médaille en or 950/1000
Dionysos et Pallas Athéna d’après une œuvre de Salvador Dali.
Frappée dans les ateliers de la Monnaies de Paris en octobre 1966.
Numérotée XVII sur XXV.
Diamètre : 8,1 cm – Poids : 464,27 g
Avec un certificat de garantie de l’administration des monnaies et médailles de Paris.
3 000 € - 6 000 €

Lot 105
Sam FRANCIS (1923-1994)
Sans titre, 1960.
Aquarelle, dédicacée, datée et signée au verso :
For Sigi from Sam, Nov 2 1960, Bleiburg
24 x 32,5 cm
4 000 € - 8 000 €

Lot 106
Hans HARTUNG (1904-1989)
PEINTURE N°10 «T 47.10»
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 47 janvier.
146 x 97 cm
Provenance :
Galerie Louis Carré Paris.
Expositions :
- Peintures d’aujourd’hui, Musée de Nîmes, 29 octobre-27 novembre 1949
- Advancing French Art, American Federation of Arts exhibition, Louis Carré Gallery, 4-25 mars 1951
- Nouvelles tendances de l’Ecole de Paris, Kunsthalle Berne, février 1954
- Hartung, Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 3-21 avril 1954, n°9
- Six peintres de l’école de Paris, Galleri Kaare Berntsen, Oslo, 20 nov.-8 déc. 1959
- Hans Hartung, The Lefevre Gallery, Londres, janvier-février 1969, n°1
- Hans Hartung, Fondation Sonja Henie Niels Onstad, Oslo, août 1981-janvier 1982
« Ne plus rien figurer, ce que j’aime faire, c’est agir sur la toile…» Hans Hartung
Hans Hartung (1904-1989), né à Leipzig, est élevé à Bâle puis Dresde , où il est inscrit à l’Akademie der Künste. Il y assiste à une conférence de Kandinsky parlant de l’abstraction comme d’une « valeur acquise dans l’histoire de l’Art ».
Il effectue un premier voyage en France en 1926, s’inscrivant à l’Académie André Lhote.
Il voyage, étudie et travaille entre la France, Dresde, Munich, l’Espagne et la Norvège jusqu’en 1935 où il s’établit définitivement à Paris. Il est naturalisé français en 1946.
Hartung présente sa première exposition personnelle à Paris, en février 1947, à la galerie Lydia Conti; en juillet de la même année, il expose au Salon des Réalités Nouvelles avec Mathieu, Wols, Bryen, Schneider et Poliakoff et devient l’un des chefs de file de l’art informel en France.
Il est considéré comme l’un des principaux représentants de la peinture abstraite.
250 000 € - 350 000 €

Lot 107
Louis MARCOUSSIS (1883-1941)
Composition
Fixé sous verre, signé en bas à gauche et daté 1921 en bas à droite (petites cloques).
19,5 x 16 cm
Provenance :
Rachel Adler Gallery, New York.
Galerie Thomas, Munich.
6 000 € - 12 000 €

Lot 108
Paul MANSOUROFF (1896-1983)
Étude, circa 1960
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, dédicacée pour mon chere Amie (come movese SOUVENIR) NANE STERN 120/11 73-20/1 74 , Bonne Année.
116 x 29 cm
Provenance :
Nane Stern, Paris, (n°234/15).
3 000 € - 8 000 €

Lot 109
Henri MARTIN (1860-1943)
Le pont à Labastide-du-Vert
Huile sur toile.
65,5 x 94 cm
En 1900, Henri Martin acquiert la propriété de Marquayrol, à Labastide-du-Vert, dans le Lot sans se douter que sa vie et son oeuvre en seront illuminées. Il y séjourne habituellement de mai à novembre. Durant quarante ans, il peint des vues de Labastide-du-Vert, de son pont enjambant le Vert, menant des recherches sur les ombres, les lumières et l’eau, variations chromatiques et cadrage, élevant ce simple pont au rang de sujet pictural.
Le procédé pointilliste est parfaitement adapté pour rendre la palpitation de la lumière dont il cherche à saisir les changements de tonalités au fil des heures et des saisons.
La datation exacte des oeuvres est parfois difficile à établir puisqu’une toile commencée une année peut être continuée l’année suivante. Il ne signe ses tableaux qu’au moment de les vendre et encore sans accorder une grande signification à ce geste.
40 000 € - 60 000 €

Lot 110
Édouard VUILLARD (1868-1940)
Misia et Thadée Nathanson à Cannes, la lecture, 1901
Huile sur toile, porte le cachet de la signature en bas à droite.
53 x 58 cm
Bibliographie :
Antoine Salomon et Guy Cogeval, Vuillard, le Regard innombrable, catalogue critique des peintures et pastels, 2003, Skira/Wildenstein Institute, Paris, vol. II, p.842, n°VIII-25.
Thadée Natanson, directeur de la Revue Blanche, épouse Misia Godebska en 1893. Elle accueille chez eux les plus proches collaborateurs et amis de son mari, parmi lesquels Vuillard, dont elle devient très vite la muse.
De 1896 à 1899, ils partent régulièrement en villégiature à trois. Nombreux sont les portraits de Misia à cette époque, plus rares ces scènes représentant le couple Natanson, qui divorcera en 1905.
30 000 € - 60 000 €

Lot 111
Wilhem Claesz HEDA (Haarlem, 1593 - 1680)
Nature Morte au rohmer, nautile et gobelet en argent
Panneau. Signé et daté 1642 en bas vers le milieu.
58,5 x 79 cm
Inscrit à la Guilde de Saint-Luc de Haarlem en 1631, Willem Claesz Heda s’illustre tout particulièrement dans le genre de la nature morte et plus spécialement dans les « banketje ». Ces collations, repas inachevés ou interrompus, mettent en scène de façon savante mais naturelle des objets précieux et raffinés et permettent à l’artiste d’exprimer toute sa virtuosité. Alors que, dans les années 1620-1630, Heda réalise des natures mortes marquées par une certaine monochromie, les années 1640 voient l’introduction de compositions plus chargées, où la couleur joue un nouveau rôle. Le nautile monté en argent, élément récurrent dans ces compositions et objet typique du cabinet de curiosité, est représentatif de cette volonté nouvelle de raffinement. On le retrouve d’ailleurs dans plusieurs œuvres datées de 1641 (La tourte au cassis, panneau, 60 x 77 cm, Strasbourg, musée des Beaux-Arts) ou de 1642 (Nature morte, panneau, 65 x 74,5 cm, Saint-Étienne, musée d’Art Moderne).
Dans notre tableau, daté de 1642, Heda parfait ses harmonies de gris, d’argent et de blanc en les relevant de touches de bleu, rose ou rouge, par le détail du manche du couteau et du nautile. Ceux-ci se détachent sur la nappe blanche aux plis lourds, dont le bord est simplement souligné par un ourlet. La forte présence de cette nappe est idéalement contrebalancée par les tons chauds de la table, le brun doré des noisettes et du rohmer, ainsi que par le rai de lumière qui vient détacher du fond du tableau le délicat verre en cristal. C’est également la lumière qui anime les différents objets, jouant dans les ciselures de l’argent, de la timbale à la monture du nautile. Le citron à demi-pelé dont l’écorce se détache en spirale ainsi que les fruits s’échappant de la tourte introduisent un certain dynamisme, le manche de la cuillère reposant légèrement sur la nappe renforçant l’impression d’une collation tout juste interrompue.
Willem Claesz Heda livre ici une de ses plus belles compositions, où la simplicité de la mise en scène accentue le raffinement des objets, sa virtuosité s’illustrant aussi bien dans la texture dans la nappe que dans les reflets mordorés du rohmer et de l’argent.
Provenance :
Vente anonyme, 12 décembre 1989, Paris, Hôtel Drouot (Me Millon et Jutheau), lot 30 (2 900 000 F).
Rapport de condition sur demande.
200 000 € - 300 000 €

Lot 112
Vase Canope au nom du Prêtre-embaumeur Psammétique-men
La panse est gravée de six colonnes hiéroglyphiques avec la formule traditionnelle plaçant le contenu du vase (l’estomac) sous la protection de Neith et de Douamoutef (version XIXc de K. Sethe), la titulature et le nom indiqués deux fois “Paroles dites par Neith : Je passe le matin et le soir, chaque jour à assurer la protection de Douamoutef qui est en moi, la protection de l’Osiris le Chef des chanceliers du dieu, le Prêtre-sem, l’Embaumeur, le Préposé aux affaires confidentielles de toute ouâbet (la place d’embaumement), le Prêtre nedjem-séti (“à l’odeur agréable”) Psammétique-men, juste de voix ; la protection de Douamoutef, l’Osiris le Chef des chanceliers du dieu, le Prêtre-sem, l’Embaumeur, le Préposé aux affaires confidentielles de toute ouâbet, le Prêtre nedjem-séti Psammétique-men, juste de voix ; c’est Douamoutef.”
On y joint un bouchon simiesque provenant d’un autre trousseau à l’effigie de Hâpi.
Albâtre.
Bouchon antique rapporté.
Égypte, nécropole memphite, Basse Époque, XXVIe dynastie.
Hauteur corps du vase : 35 cm - Hauteur bouchon : 7 cm
Provenance :
Ancienne collection Giovanni Anastasi (1780-1860), Consul général de Suède et de Norvège en Égypte de 1828 à 1857.
Vente à Paris, Me François Lenormant, 23-27 juin 1857, p. 31, n° 234 (sans bouchon), acquis par l’antiquaire parisien Kalebdjian.
Bibliographie :
Le département des Antiquités Égyptiennes du musée du Louvre conserve un exemplaire du catalogue de vente de la collection Anastasi (23-27 juin 1857) annoté par Théodule Devéria (1831-1871) avec la copie de l’inscription du vase et précisant que le monument a été acquis par l’antiquaire parisien Kalebdjian.
4 000 € - 6 000 €

Lot 113
Ensemble composé de deux vases canopes, les corps peints de registres de languettes. L’un est fermé par un bouchon à l’effigie du chacal Douamoutef. Portent plusieurs numéros de collection. Albâtre et traces de polychromie.
Égypte, Nouvel Empire.
Hauteurs : 47,5 cm (avec le bouchon) et 35,5 cm
4 000 € - 6 000 €

Lot 114
Bouchon de vase canope à l’effigie du chacal Douamoutef. Porte un numéro de collection.
Albâtre.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 17 cm
800 € - 1 200 €

Lot 115
Vase tronconique.
Albâtre (cassures).
Égypte, Ancien Empire.
Hauteur : 15 cm
100 € - 150 €