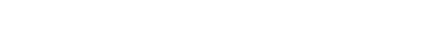Vente judiciaire MOA
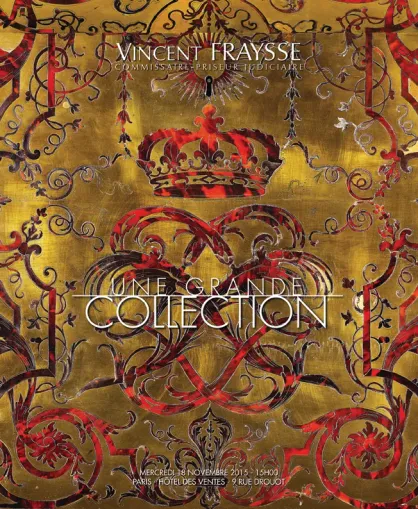
18 novembre2015
Heure15:00
LieuHÔTEL DES VENTES - 9 RUE DROUOT - PARIS - SALLE 9
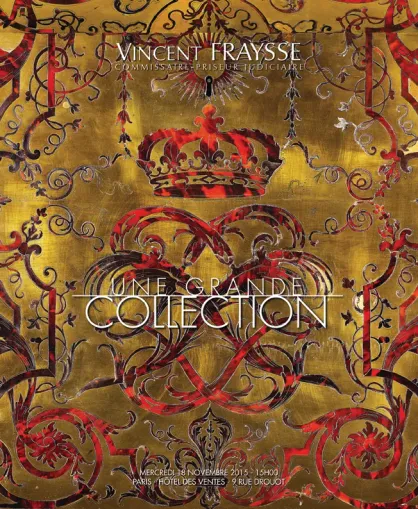
UNE GRANDE COLLECTION III.
TABLEAU ANCIEN
TABLEAUX MODERNES
IMPORTANTES PIERRES PRÉCIEUSES
MONTRES ANCIENNES
ORFÈVRERIE XVIE XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
HAUTE EPOQUE
ARCHEOLOGIE
OBJETS D’ART ET DE TRÈS BEL AMEUBLEMENT
TAPISSERIES DU XVIE SIÈCLE
Exposition

Lot 116
Portrait de jeune patricien, la coiffure formée de mèches ondulées, la pupille des yeux indiquée. Marbre blanc (restaurations, en particulier le nez et le menton).
Art Romain, IIe-IIIe siècles apr. J.-C.
Hauteur : 19 cm
1 500 € - 2 000 €

Lot 117
Relief de Persépolis. Dignitaire Mède
Relief sculpté du buste d’un dignitaire Mède vers la gauche, peuple appartenant à l’une des trois régions ancestrales de l’empire achéménide. Il est vêtu d’une robe, l’épaule gauche couverte d’un manteau, et est paré d’un collier torsadé, d’un bracelet et d’une boucle d’oreille. Le chef est coiffé d’un bonnet hémisphérique couvrant la chevelure formée de nombreuses mèches bouclées et torsadées en registres superposés. Il porte une longue moustache retombant sur la barbe fournie, traitée à l’identique de la chevelure, se terminant par de fines mèches ondulées. Il place la main droite aux doigts effilés devant la bouche pour suggérer la parole.
Calcaire.
Dans le style achéménide de Persépolis.
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 20,5 cm
Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 16 mars 1967, n° 62. Maître Maurice Rheims.
Collection Frank Elgar (1899-1978).
Hôtel Drouot, Paris, 8 mars 1989, n° 67.
Sans estimations

Lot 118
Millefleurs au lévrier et à la lionne.
Pays-Bas méridionaux, Tournai.
Vers 1500.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 150 cm
Caractéristique de la seconde moitié du XVe siècle et du premier tiers du XVIe siècle, le terme de millefleurs désigne des tapisseries dont le fond, souvent bleu foncé, est orné d’un semis de fleurs, plus ou moins stylisé, plus ou moins répétitif. Sur ces fonds se détachent des personnages, des animaux ou des armoiries.
Sur le fragment présenté, un lévrier s’élance vers la gauche et une lionne passe derrière un arbre. Une tapisserie présentée dans l’exposition Tapisseries héraldiques de la vie quotidienne (Tournai, 1970), nous montre le genre de composition dont devait provenir ce beau fragment : trois arbres parallèles avec quatre animaux dont deux passant derrière les troncs d’arbre.
Les couleurs vives et bien conservées nous permettent d’apprécier l’art des teinturiers de cette période.
De nombreuses millefleurs figurent dans les collections des musées européens et américains, mais elles sont devenues très rares sur le marché de l’art.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie (5 fils de laine au cm), la tapisserie a conservé de beaux coloris vifs ; une partie retissée.
Bibliographie :
Jean-Paul Asselberghs,1970, Tapisseries héraldiques de la vie quotidienne (Tournai, 1970), n°11.
Nello Forti Grazzini, 2015, Textiles Art Masterpieces, Tapestries and Embroideries in the Zaleski collection, la tapisserie est reproduite p.194, fig.29 31c.
15 000 € - 20 000 €

Lot 119
Tête de chevalier en pierre calcaire sculptée en ronde bosse. Visage entouré d’un haubert de mailles recouvrant la bouche et coiffé d’un casque de forme conique protégeant la nuque ; ce casque est orné de renforts se terminant par des crossettes et de fleurs de lys dressées en bordure ; visage avec yeux en amande aux paupières légèrement ourlées, nez droit et épaté.
XIIIe siècle (quelques érosions).
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 15 cm
Soclée.
2 000 € - 4 000 €

Lot 120
Feuilles de choux aux oiseaux.
Pays-Bas méridionaux, probablement Grammont.
Seconde moitié du XVIe siècle.
Hauteur : 250 cm - Largeur : 280 cm
Un large bouquet de grandes feuilles d’acanthe ourlées d’un vert profond que l’on nomme traditionnellement feuilles de choux, occupe toute la composition. Une demi-douzaine de petits oiseaux habitent ce grand motif végétal ; on aperçoit également une libellule et une sauterelle. Des fleurs grimpantes que l’on nomme aristoloches, des rosiers et des digitales s’insinuent entre les grandes feuilles et animent la composition.
La bordure est à motifs de fleurs éclatées, d’iris, de fruits et de feuilles. Elle encadre cette magistrale composition surréaliste et l’éclaire grâce à son fond clair et lumineux.
Succédant aux millefleurs du Moyen âge, les tapisseries dites à feuilles de choux apparaissent dans la seconde moitié du XVIe siècle et furent tissées aussi bien dans les ateliers des Pays-Bas méridionaux (Bruxelles, Audenarde, Enghien, Grammont, Bruges) que dans les ateliers marchois du centre de la France.
Les grands musées du monde entier possèdent une ou plusieurs tapisseries dites à feuilles de choux.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, 5 fils de chaîne au cm, trame en laine et soie), la tapisserie est dans un bel état de conservation.
Bibliographie:
Adolph Cavallo, 1967, Tapestries of Europe and of Colonial Peru in the Museum of Fine Arts of Boston, n°27.
15 000 € - 20 000 €

Lot 121
Bas-relief en marbre représentant saint Pierre en évêque. Debout, la tête auréolée et ceinte d’une mitre, il tient un livre de ses deux mains, deux clefs suspendues à sa main droite ; visage aux traits stylisés avec yeux en amande aux paupières ourlées, moustaches et barbe traitées en mèches parallèles ; il est revêtu d’une tunique tombant en plis symétriques et d’une chasuble recouvrant les épaules au plissé serré.
Italie, Toscane ? fin du XIIe siècle (manques sur le côté gauche et à la partie supérieure, cassé et recollé, renfort au dos).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 6 cm
2 000 € - 3 000 €

Lot 122
Mille fleurs à la licorne.
Aux armes de la famille de Chabannes La Palice.
Tapisserie des Ateliers de la Marche (région d’Aubusson et Felletin).
Vers 1500.
Hauteur : 210 cm - Largeur : 140 cm
Cette rare tapisserie présente les deux thèmes importants de la tapisserie du Moyen Age et de la pré-Renaissance : le décor végétal des millefleurs (ici très stylisées) et la licorne, cet animal mythique et fabuleux, symbole de pureté. La licorne utilisée en héraldique symbolise la pureté et l’honnêteté de la famille dont elle présente les armes. Ici la licorne porte les armes de l’illustre famille de Chabannes : de gueules au lion d’hermines couronnées d’or, l’écu est surmonté d’un heaume avec panaches.
Cette tapisserie a pu être tissée pour Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice et Maréchal de France (1470-1525). Il consacra sa vie au service de la France sous trois rois successifs : Charles VIII, Louis XII et François 1er. Sa réputation de bravoure le fit considérer comme l’un des hommes les plus remarquables de son temps. Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice, fut nommé Maréchal de France (1515), à l’avènement de François 1er.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie (5 fils de chaîne au cm), bon état de conservation, des anciennes restaurations.
Provenance :
Ancienne collection Thiérard Frères, Vente Palais Galliera, 30 mars 1963 Marché de l’art.
Bibliographie :
Dominique Chevalier, P. Chevalier, P-F. Bertrand,1988, Les Tapisseries d’Aubusson et Felletin, repr. p. 19.
Expositions :
La tapisserie a figuré dans une exposition à Paris en 1935 et à Arras en 1963, Les Tapisseries d’Aubusson et Felletin, n° 2 du catalogue, p. 17, la pièce est intitulée Licorne sur fond de fleurettes.
25 000 € - 45 000 €

Lot 123
Saint Jacques à cheval en bois de résineux sculpté en ronde bosse polychromé et doré. Sur le cheval cabré, il est revêtu d’une armure au plastron ceint d’une écharpe.
Espagne, XVIIe siècle (petits accidents et restaurations).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 22 cm
1 000 € - 2 500 €

Lot 124
La Fille de Jephté
Tapisserie allemande armoriée.
Région de Hambourg, XVIIe siècle, vers 1600-1620.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 75 cm
Iconographie :
La scène est rapportée dans le livre des juges (11, 34) : Jephté, partant en campagne, fit un vœu à l’Eternel : « si tu livres les enfants d’Ammon entre mes mains, celui qui sortira des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux, appartiendra à l’Éternel et je l’offrirai en holocauste... Et voici que sa fille, son unique enfant, sortit à sa rencontre, en dansant, et en jouant du tambourin. Elle demanda à pleurer deux mois sa virginité dans la montagne, puis elle revint pour être sacrifiée ».
Malgré la petite taille de la tapisserie, la composition très ramassée a un caractère de grandeur majestueuse, elle est monumentale. La scène du sacrifice dans la partie supérieure droite, ne nous laisse guère de doute sur l’issue fatale du vœu imprudent, même si, comme l’indique Louis Réau (op.cit), suivant une autre interprétation, le sacrifice de la fille de Jephté serait seulement celui de renoncer aux joies du mariage et de la maternité en offrant sa virginité à Iahvé...
Une tapisserie similaire mais ne comportant pas d’armoiries est reproduite dans l’ouvrage de Göbel (op.cit) au numéro 96a. Elle est indiquée comme feuille de coussin, mais les dimensions ne sont pas indiquées. La tapisserie présentée ici nous paraît trop grande pour être qualifiée de feuille de coussin comme la tapisserie présentée dans Göbel 1934. Pour nous, il s’agirait plutôt d’une petite tapisserie utilisée dans un oratoire privé. La présente tapisserie comporte des armoiries non identifiées par l’héraldiste consulté mais bien, d’après lui, dans le style des armoiries de la région de Hambourg.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie, chaîne en laine (8 fils de chaîne au cm), trame en laine et soie, la tapisserie est dans un bel état de conservation, galon bleu et vieil or rapporté.
Bibliographie :
Heinrich Göbel, 1934, Wandteppiche - Die Germanischen und Slavischen Länder III, 2, n°96 A.
Louis Réau, 1956, Iconographie de l’Art chrétien, trois tomes, tome II, vol 1- p.234-235.
3 000 € - 6 000 €

Lot 125
Charlemagne, St-Jacques et la bataille de Roncevaux
Bruxelles, XVIe siècle, vers 1520.
Hauteur : 125 cm - Largeur : 180 cm
On pourrait ainsi intituler ce très beau fragment provenant de la partie supérieure droite d’une tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle intitulée Le Triomphe de la Foi qui s’inscrit dans un ensemble de tapisseries intitulé Le Triomphe des sept vertus.
Les inscriptions sur les vêtements et armures des personnages nous renseignent :
En bas à droite, CAROLUS pour l’Empereur Charlemagne qui prie la Vierge (la Vierge au pilier, vénérée en Espagne) après le décès de son neveu Roland ; ROLAO est inscrit à côté d’un guerrier mort, de même OLIVERI pour Olivier le compagnon de Roland, abattu également en défendant le col de Roncevaux contre les Sarrasins. A travers les nuées, Saint-Jacques le majeur, à cheval, dit aussi Saint Jacques Matamore (le Saint tueur de maures), rappelle que ce saint avait promis à Charlemagne d’être à son secours en toutes choses après lui avoir demandé d’aller délivrer son tombeau.
Matériaux et état :
Tissé en laine et soie, bon état, mais fragment.
Bibliographie :
Geneviève Souchal, 1979, The Triumph of the Seven Virtues dans Acts of the Tapestry Symposium, San Francisco,1976, pp.103 -153.
Reproduction d’un exemplaire d’une tapisserie complète du Triomphe de la Foi, conservée aux États-Unis à Biltmore House, Asheville, North Carolina, p.106.
3 000 € - 6 000 €

Lot 126
Bargueño et son piétement en noyer et os, sculptés, polychromés et dorés. Il ouvre à un abattant découvrant douze tiroirs et une porte centrale avec cabinet intérieur à six tiroirs ; riche décor architecturé et géométrique avec colonnettes, frontons, acrotères, rosaces et losanges. La partie basse ouvre par deux tiroirs et deux portes ornés de rosaces, losanges et chevrons ; belle ferronnerie ajourée, gravée et dorée : grande serrure à double moraillons, verrous avec platine et plaques ornementales losangées posées sur velours rouge, têtes de clous en forme de coquille, cornières, poignées latérales.
Espagne, XVIIe siècle (légers manques et restaurations).
Hauteur : 150 cm - Largeur : 112 cm - Profondeur : 44 cm
3 000 € - 6 000 €

Lot 127
Fauteuil à haut dossier en noyer au piétement tourné en balustres, entretoise en H, accotoirs à crosse.
XVIIe siècle (petites vermoulures).
Hauteur : 120 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 51 cm
300 € - 500 €

Lot 128
Deux chaises pouvant former paires en noyer, piétement tourné en balustres, entretoise en H, pieds en demi-sphère.
XVIIe siècle (petites vermoulures, un pied enté).
Hauteurs : 97 cm et 95,5 cm - Largeur : 55 cm - Profondeur : 50 cm
200 € - 500 €

Lot 129
La Prédication de Jean Baptiste
Partie de tapisserie de chœur.
Fin du XVe siècle.
Probablement atelier français.
Hauteur : 175 cm - Largeur : 178 cm
Au centre de la tapisserie, se tient Jean Baptiste, le précurseur du Messie, vêtue d’une tunique en peau de chameau (mélote). Il est entouré de plusieurs prêtres et lévites. Les personnages se détachent sur un parterre de millefleurs. Dans la partie supérieure, on distingue des scènes annexes avec le Christ et Jean Baptiste. Au-dessus de la tête de St Jean Baptiste, on peut lire l’inscription suivante en latin dans un phylactère :
Ego vox clamatis in deserto dirigite viam domini
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin du seigneur ».
Dans le bas de la tapisserie, d’autres phylactères avec des inscriptions en français :
A gauche : miséricorde de l’agneau de concorde.
A droite : vérité joie par le pur ? Sang.
Jean Baptiste est le dernier prophète de l’ancien testament et le premier martyr du nouveau testament (avant la mort de jésus), c’est un proto martyr.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie (6 fils de chaîne au cm), la tapisserie est en bon état, mais présente des anciennes restaurations.
Bibliographie :
G.J. Demotte, 1924, la Tapisserie gothique, le présent panneau est reproduit (planche 63) ainsi qu’un autre panneau de la même tapisserie de chœur.
15 000 € - 25 000 €

Lot 130
Bureau livré en 1685 pour Louis XIV provenant du Petit Cabinet du roi à Versailles,
par Alexandre-Jean Oppenordt, ébéniste du roi.
Chêne, bois résineux, placage d’ébène et de palissandre de Rio, marqueterie en seconde partie de laiton et d’écaille rouge gravée.
Hauteur : 92 cm – Largeur : 101 cm – Profondeur : 54,5 cm
Modifications.
Provenance :
Louis XIV au château de Versailles en 1685.
Vendu par l’administration du Garde Meuble de la Couronne, le 12 juillet 1751, à Centenier, marchand, rue de la Verrerie à Paris.
Ferdinand James Anselm von Rothschild, baron de Rothschild (1839-1898), qui l’offrit à Constance Gwladys Robinson, marquise de Ripon (1859-1917), puis sa fille Gladys Mary Juliet Lowther, Lady Duff (1881-1965).
Vente Sotheby’s, Londres, 12 juillet 1963, n°163.
Ce bureau transformé à deux rangs de tiroirs disposés dans les caissons latéraux et dans le renforcement médian, présente un plateau décoré d’un ample motif centré autour du monogramme à deux L entrelacés composés de palmes, timbré par une couronne royale surmontée par un soleil flanqué de guirlandes et chutes à fleurons feuillagés. En dessous du monogramme royal, les branches latérales d’une petite fleur de lis se prolongent avec des volutes qui délimitent la réserve centrale ; celle-ci est flanquée en largeur par deux lyres d’Apollon, tandis que les écoinçons du plateau renferment des lis également monogrammés. Le chiffre du roi est omniprésent dans la marqueterie du bureau : il entoure les entrées de serrure sur les deux tiroirs des corps latéraux et sur ceux du caisson médian ; il forme également le motif central des grands panneaux des côtés dont les écoinçons sont eux-aussi fleurdelisés. L’abattant laisse découvrir deux rangées de trois tiroirs, surmontées par des niches ouvertes et disposées de part et d’autre d’un caisson médian à une tablette. A l’intérieur, le bureau ainsi que le cadre de l’abattant garni d’un maroquin rouge postérieurement sont plaqués en bois de rapport. Le bureau repose sur deux groupes de quatre pieds en gaine cannelée, à tailloirs et bases en bronze doré, dont ceux aux extrémités ont été munis de roulettes et les autres finissent par leurs petites toupies en bronze, réunis par deux entretoises sinueuses à pièce centrale circulaire, recouvertes de motifs de rinceaux et de rosaces marquetés.
Ainsi que son pendant en première partie, conservé au Metropolitan Museum de New York (fig. 1-2), notre bureau, même si transformé, constitue l’une des deux seules pièces de mobilier connues actuellement, qui furent réalisées indubitablement par Alexandre-Jean Oppenordt (v.1639-1715), ébéniste ordinaire du roi, lequel, avec André-Charles Boulle, figurent parmi les plus éminents artistes décorateurs du bois du règne de Louis XIV.
Commandés par les Bâtiments du roi avant juin 1685 et payés le 25 juillet de la même année sur les comptes de cette administration, où on peut lire « A Jean Oppenor, ébéniste, pour compartimens faits aux deux bureaux du petit cabinet de S.M, 240 lt », les meubles furent aussitôt envoyés à Versailles pour le Cabinet où le roi écrit. Leur exécution devait être déjà, parachevée le 24 juin 1685, car à cette date le doreur Robillard avait été payé 61 livres par les Bâtiments du roi « pour la dorure qu’il a faite aux serrures » des mêmes bureaux.
Leur historique est connu depuis 1986, grâce à l’étude de J.-N. Ronfort. Les bureaux, qui n’avaient pas été inscrits dans l’Inventaire général des meubles de la Couronne de 1705, figurent sous le numéro 561 dans celui de 1729 : « Deux bureaux de marqueterie d’écaille de tortue et de cuivre representans au milieu les chiffres du Roy couronnés et surmontés d’un soleil, et à chaque coin une grande fleurs de lis, aiant pardevant neuf tiroirs fermans à clef portés sur huit pilliers en gaine de même marqueterie à bazes et chapiteaux de cuivre doré. Long chacun de trente neuf pouces [105,57 cm] sur vingt deux de large [59,55 cm] et vingt neuf [78,50 cm] de haut, avec leurs tapis de maroquin rouge doublés de serge et garnis de molet d’or ».
Faisant auparavant fonction de cabinet de garde-robe, le Petit cabinet, situé derrière la Grande galerie du château de Versailles, entre le Cabinet des Termes et un autre cabinet exigu où se trouvait la chaise, communiquait aussi avec l’escalier demi-circulaire, qui permettait la circulation privée de l’appartement du roi (fig. 3).
De forme octogone, il était éclairé par une croisée sur la Cour du roi et comportait une cheminée dans l’une des niches formant les pans coupés, au nord-ouest (fig. 4). Aménagé en Cabinet où le roi écrit vers 1683, il allait être remanié en 1692, pour disparaître définitivement sous le règne de Louis XV.
C’est dans cette pièce que notre bureau ainsi que son pendant furent installés dans les niches latérales, vraisemblablement de part et d’autre de la porte de communication avec le Cabinet des Termes. Considérés démodés sous le règne de Louis XV, comme la plupart des meubles de son bisaïeul, ils furent soldés par l’administration du Garde Meuble de la Couronne, qui organisa plusieurs ventes des « Meubles du Roy », dont celle du 12 juillet 1751 consigne sous le n°421, le bureau en première partie, aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York, qui fut acheté par le marchand ébéniste Gilles Joubert pour 40 livres, et sous le n°422, notre bureau : « Item, Nous avons Exposé en vente un autre pareil bureau de marqueterie à neuf tiroirs faisant partie de l’article cent quatre vingt quinze dudit Etat, au Sieur Centenier, demeurant rue de la Verrerie, 40 lt ». Comme à l’accoutumé à l’époque, les meubles marquetés en contrepartie étaient présentés lors des enchères à la suite de ceux en première partie.
Ces bureaux correspondent au modèle déjà classique à l’époque de leur fabrication, dit « brisé », car le plateau articulé pouvait s’ouvrir en deux parties. Même si le paiement des Bâtiments ne mentionnait que des panneaux marquetés, il faut attribuer à Oppenordt la conception et l’entière réalisation des bureaux. A une exception près : le plateau avait été certainement exécuté d’après une composition élaborée par Jean Ier Berain, dessinateur de la Chambre du roi ; d’où son
aspect plus flamboyant, foisonnant de rinceaux et de jeux de volutes entrelacées qui forment une grande réserve centrale, d’un aspect bien individualisé. Manifestement, le modèle de Berain eut une heureuse fortune : d’une part, dix ans après la livraison des deux bureaux, il fut repris en marqueterie de cuivre, d’ébène et de bois violet sur le plateau d’une commode livrée par Renaud Gaudron en octobre 1695 pour Marly. Ce qui prouve une certaine inertie de l’administration royale qui entendait utiliser encore le projet de Berain longtemps après sa création. D’autre part, Oppenordt lui-même s’appropria ce décor et l’adapta par la suite sur plusieurs de ses créations, notamment sur le plateau d’une commode en contrepartie et sur deux autres dont une provenant de l’ameublement de Charles-Henri Malon de Bercy, au château de Bercy.
Nous ignorons les tribulations de notre bureau après la vente de 1751. Comme beaucoup de meubles de provenance royale, il dut vraisemblablement quitter la France pendant les troubles de la période révolutionnaire. Toujours est-il que le bureau se trouvait au XIXe siècle en Angleterre et appartenait à Ferdinand James Anselm de Rothschild (1839-1898), lorsqu’il fut transformé en secrétaire de pente par l’adjonction sur les côtés et à l’arrière du bâti de panneaux de bois permettant de former l’inclinaison de l’abattant. De ce fait, chacun des panneaux latéraux a été amputé de l’un de leurs angles, coupant une partie de la fleur de lis marquetée. Les panneaux en forme de parallélépipèdes irréguliers, rajoutés en surélévation, ont été revêtus de remplois des faux tiroirs en ceinture supprimés, où l’on retrouve les mêmes motifs, les monogrammes et la fleur de lis. L’ancienne brisure du plateau, dépourvu de son rebord en cavet, a été à son tour comblée et remplacée par une nouvelle, située au dessus du soleil anthropomorphe. Le nouvel abattant ainsi obtenu, qui une fois ouvert offre un espace de travail plus important, découvre deux rangées chacune de trois tiroirs, situés de part et d’autre d’une niche compartimentée en deux par l’adjonction d’une tablette. Des roulettes en bronze furent rajoutées à quatre des pieds du bureau pour faciliter son déplacement.
Issu de la branche autrichienne de la célèbre famille de banquiers, le baron Ferdinand de Rothschild est né à Paris, éduqué à Vienne et s’établit en Angleterre dans les années 1860, où il fut naturalisé en 1883 et accéda au pairie en 1885. Politicien libéral, il siégea à la Chambre des Communes entre 1885 et 1898 et fut shérif de Buckinghamshire dès 1883. Philanthrope, il fonda plusieurs institutions charitables au Royaume Uni et fut l’un des plus importants amateurs d’art et collectionneurs de la seconde moitié du XIXe siècle. Passionné par la Renaissance, le baron de Rothschild confia à l’architecte Hippolyte
Destailleur (1822-1893) l’édification de sa demeure de Waddesdon, que celui-ci réalisa entre 1874 et 1889 en reprenant des éléments d’architecture des monuments français du XVIe siècle, notamment l’escalier du château de Blois, etc. Ici, il reçut la reine Victoria le 14 mai 1890, mais aussi l’empereur Frédéric d’Allemagne ou le shah de Perse. L’architecture de la demeure, son aménagement intérieur et ses collections richissimes devinrent synonymes du « goût Rothschild ». C’était normal que le baron Ferdinand fût ainsi intéressé par ce bureau dont toute la décoration évoquait la provenance royale française. Peut-être son état de conservation moins bon que celui de sa paire en première partie le décida de remanier le bureau et de l’amener dans sa forme actuelle.
Fidèle dans ses amitiés, Ferdinand de Rothschild offrit le bureau à Constance Gwladys Robinson, marquise de Ripon (1859-1917), avec laquelle il partageait le même engouement pour les arts du spectacle. Elle-même mécène des arts, la marquise était une amie d’Oscar Wilde, qui lui dédia sa pièce de théâtre À Woman of No Importance, contribua au succès londonien de Nellie Melba, mais aussi de Nijinsky et de Diaghilev. A son décès, le bureau fut hérité par sa fille Lady Gladys Mary Juliet Lowther, née en 1881 de son premier mariage avec St. George Henry Lowther, 4e comte de Lonsdale. Celle-ci épousa en 1903 Sir Robert George Vivian Duff, 2e baronnet Duff, qui fut tué en 1914 pendant la Grande Guerre. A l’instar de sa mère Lady Duff fut une protectrice des arts et une amie des artistes. C’est de ses collections que notre bureau fut vendu en 1963.
Originaire de la ville et duché de Gueldre, où il naquît vers 1639, Alexandre-Jean Oppenordt était issu peut-être d’une famille protestante et était le fils d’un boucher, Henri Oppen Oordt et de Marie Tendart. Il émigra en France dans les années 1655-1660, fit son apprentissage avant 1668 dans l’atelier de César Campe, autre ébéniste du Garde Meuble de la Couronne, et fut naturalisé par lettres enregistrées dans la Chambre des Comptes le 22 octobre 1679. Installé au début dans l’enclos du Temple à Paris, il reçut un brevet de logement aux galeries du Louvre le 18 mars 1684, puis un second logement, dès 1691, rue Champfleury, dans une maison appartenant au roi, où il installa ses deux ateliers. Il devint ébéniste ordinaire du roi en 1684, charge qu’il conserva jusqu’à la fin de sa vie, comme en témoignent les Comptes des Bâtiments du roi, pour lesquels il réalisa, entre autres, les médaillers pour le Cabinet des médailles du roi en 1684 et 1686, le bureau pour le Cabinet des curiosités en 1684, le parquet de la Petite Galerie de Versailles, en 1686, etc. Son fils, Gilles-Marie, qui francisa son patronyme en Oppenort, devint architecte, voyagea en Italie où il fut très influencé par le baroque romain, exerça en tant qu’architecte du Régent et parvint à la noblesse par lettres de janvier 1722. Alexandre-Jean Oppenordt décéda le 11 mars 1715 et légua son atelier au fils d’Anne Monpetit, sa domestique, Etienne Goy, formé peut-être par le maître lui-même, qui fut envoyé en possession du legs le 25 avril 1715 et continua vraisemblablement pendant un certain temps de produire des meubles ou d’écouler le solde de pièces restantes de son donataire.
Nous remercions Calin Demetrescu pour la description de ce bureau.
1. Inv. 1986.365.3.
2. J. Guiffrey, Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, t. II, Paris, Imprimerie Nationale, 1887, col. 761.
3. Ibid., col. 629.
4. J. N. Ronfort, « Le mobilier royal à l’époque de Louis XIV. 1685. Versailles et le bureau du roi », L’Estampille, 191, avril 1986, p. 44-51. Les informations de cet article ont été reprises depuis par J. Parker e.a., French Decorative Arts during the Reign of Louis XIV, 1654-1715, New York, 1989, et par D. Kisluk-Grosheide, e.a., European Furniture in The Metropolitan Museum …, New York-New Haven-London, 2006, cat.17, p. 50-53.
5. Arch. nat., O1 3333 : Inventaire général des meubles de la Couronne, qui fut publié par J. Guiffrey en 1885-1886 et sur lequel les bureaux ne sont pas mentionnés.
6. Arch. nat., O1 3336 : Inventaire général..., du 31 décembre 1729 ; c’est sur cet exemplaire de l’inventaire dressé à l’initiative de Gaspard-Moïse-Augustin de Fontanieu (1694-1767), qu’on retrouve les bureaux sous le numéro 561.
7. Arch. nat., O1 3336 : Inventaire général..., du 31 décembre 1729 ; c’est sur cet exemplaire de l’inventaire dressé à l’initiative de Gaspard-Moïse-Augustin de Fontanieu (1694-1767), qu’on retrouve les bureaux sous le numéro 561.
8. Arch. nat., O1* 3306 : Journal du Garde Meuble de la Couronne. Une annotation en marge précise que la commode, décrite comme « une grande table en bureau, garnie de trois grands tiroirs […] sur le dessus de ladite table est gravé les chiffres du Roy couronnez, avec des lyres d’Apollon aux costez et des chiffres aux quatre coins accompagnez d’ornemens », etc., avait été inventoriée au chapitre des « Cabinets au N°487 ». En effet, la même description se retrouve sous ce numéro, dans J. Guiffrey, Inventaire général..., t. II, 1886, p. 172.
9. Christie’s, Londres, 13 juin 1991, n°88, puis Sotheby’s, Paris, 23 mars 2006, n°63.
10. Respectivement Christie’s, Londres, 6 décembre 1979, n°138, puis Christie’s, Londres, 8 décembre 1994, n°545 et Christie’s, Genève, 18 novembre 1974, n°57, ensuite Sotheby’s, New York, 19 novembre 1993, n°35, puis Christie’s, Londres, 15 juin 1995, n°50.
Sans estimations

Lot 131
Le Triomphe d’Esther et l’arrestation des eunuques
Tapisseries des Pays-Bas méridionaux.
Attribuée à Bruxelles.
XVIe siècle, vers 1527/30.
Hauteur : 334 cm - Largeur : 260 cm
Iconographie :
Extraits de l’Ancien Testament - Livre d’Esther - II - 17 à 23 :
« Après avoir été menée à la chambre du roi, Assuérus l’aima plus que toutes ses autres femmes, et elle s’acquit dans son cœur et dans son esprit une considération plus grande que toutes les autres. Il lui mit sur la tête le diadème royal, et il la fit reine à la place de Vasthi. Et le roi commanda qu’on fit un festin très magnifique à tous les grands de sa cour et à tous ses serviteurs, pour le mariage et les noces d’Esther... Bagathan et Tharès, deux des eunuques du roi, ayant conçu quelque mécontentement contre le roi, entreprirent d’attenter sur sa personne et de le tuer. Mais Mardochée, ayant découvert leur dessein, en avertit aussitôt la reine Esther. La reine en avertit le roi au nom de Mardochée... »
Comme dans la célèbre tenture de David et Bethsabée du Musée National de la Renaissance à Ecouen, il s’agit d’un thème biblique traité avec des personnages en costumes contemporains. Ce parti pris, caractéristique de l’époque, apporte une saveur particulière au sujet. C’est toute une époque qui nous et ainsi restituée avec la richesse des étoffes, des drapés, des coiffures et des bijoux. La narration s’organise sur deux registres :
Dans la partie supérieure, Assuérus est assis sur le trône, Esther à ses côtés.
Dans le registre inférieur, la scène d’arrestation.
Il est intéressant de noter qu’Assuérus, contrairement à d’autres représentations, n’est pas barbu mais imberbe. Il est très probable qu’Assuérus est représenté sous les traits de Charles Quint (né en 1500, devenu empereur en juin 1519) qui épousa Isabelle de Portugal en 1526. On reconnaît son menton très caractéristique.
La composition est ramassée sans doute pour répondre à une demande d’un format particulier, mais répond aussi à l’ancienne tradition qui permettait de raconter beaucoup en peu d’espace et de ne pas déroger au principe de l’horror vacui (l’horreur du vide).
Tapisseries en rapport :
Une tapisserie de Bruxelles très proche se trouvait ces dernières années sur le marché de l’Art et représentait Les Eunuques Baghatan et Tares amenés devant Esther et Assuérus.
Origine du modèle :
Probablement dû à un peintre de l’entourage de Jan van Roome, (Jean van Roome est à l’origine des modèles de la tenture de David et Bethsabée du Musée National de la Renaissance). Le portrait de Charles Quint/Assuérus est inspiré des gravures de Hans Weiditz.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie : chaîne en laine (6 fils de chaîne au cm), trame en laine et soie.
La tapisserie est dans un bon état de conservation. Une petite partie retissée dans la bordure droite.
20 000 € - 40 000 €

Lot 132
Grand et large fauteuil à dossier plat et à châssis en bois naturel mouluré sculpté d’agrafes, vagues, enroulements feuillagés. La ceinture et le dossier sculpté de grenades éclatées dans un cartouche, les attaches d’accotoirs de crossettes, la bordure du châssis simulant un ruban de passementerie.
Epoque Louis XV, attribué à CRESSON. (décapé, petits accidents, rebouchage)
Hauteur : 107 cm - largeur : 77 cm – profondeur : 58 cm
Louis CRESSON reçu Maître menuisier le 28 Janvier 1738. Spécialiste de sièges, il fabriqua le fauteuil roulant du jeune duc de Bourgogne.
Bibiographie :
Il livra les sièges conservés dans de grandes collections, notamment le fauteuil Louis XV à la Reine conservé à Waddesdon Manor. On reconnait son art avec la grenade éclatée. Notre fauteuil monté à chassis présente la particularité d’un ruban sculpté simulant un galon. Ce thème est également repris par la suite dans les œuvres de Louis Delanois.
3 000 € - 5 000 €

Lot 133
Bureau dit Mazarin en marqueterie de laiton gravé découpé sur fond d’écaille rouge de forme rectangulaire. Il présente 7 tiroirs et une porte. Les angles à ressauts. Le plateau marqueté sur fond d’écaille rouge d’un grand décor de rinceaux et enroulements. Le pourtour orné de zéphires ou de termes, de vases d’où s’échappent des feuillages et des animaux fantastiques. La partie centrale à décor de danseurs, d’amour sur une balancelle, de sphinges et papillons. Au centre un coq triomphant sous un dais en rappel sur la porte. Tous ces éléments sont inspirés des gravures de Jean BERAIN, de GILLOT et surtout de Claude III AUDRAN. Il repose sur 8 pieds à pans réunis par deux entretoises en X. Ces dernières reposant sur des pieds toupie.
Epoque Louis XIV. (accidents, usures et restaurations)
Hauteur : 77 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 61 cm
Les zéphyrs, les enfants musiciens, les vases fleuris sont un thème récurrent notamment dans l’œuvre de Nicolas Sageot.
Voir également les commodes de la Wallace collection (Ref. F39 et F408) qui offrent des décors se rapprochant.
8 000 € - 15 000 €

Lot 134
Esther et Assuérus
Pays-Bas méridionaux, probablement Tournai.
XVIe siècle, vers 1520.
Marque non identifiée dans le galon en bas à droite (replié)
Hauteur : 280 cm - Largeur : 345 cm
Iconographie :
A la cour d’Assuérus, sa jeune et nouvelle épouse, la juive Esther, apprend qu’Aman va faire promulguer un décret afin d’exterminer les juifs. Mardochée, son tuteur, lui demandera d’intercéder auprès du roi afin de sauver les juifs de la mort.
Au centre de la composition, Assuérus, le sceptre à la main, à sa gauche et de face, le vizir Aman (son visage reflète ses mauvaises intentions !) remet au chambellan Hatach le décret décidant de l’extermination des juifs. A droite, la reine Esther, accompagnée d’une suivante et de Mardochée, s’apprête à paraître devant le roi.
La composition de la partie basse de cette très belle tapisserie annonce les grandes compositions bruxelloises de la Renaissance flamande, tandis que la persistance d’une composition sur deux registres reste encore gothique.
Comme dans la célèbre tenture de David et Bethsabée du Musée National de la Renaissance à Ecouen, il s’agit d’un thème biblique traité avec des personnages en costumes contemporains. Ce parti pris apporte une saveur particulière au sujet.
La composition s’inscrit dans une étroite et élégante bordure à décor de fleurs et de fruits (dont des grenades) très naturalistes.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, 5 fils de chaîne au cm, trame en laine et soie), la tapisserie est dans un bon état de conservation, les coloris sont restés vifs.
30 000 € - 50 000 €

Lot 135
Paire d ’encoignures livrées par Jean-Henri Riesener pour le Petit Trianon à Versailles
Paire d’encoignures en acajou et placage d’acajou, plateau de marbre blanc.
Epoque LOUIS XVI. (accidents, usures)
Jean-Henri Riesener (1734-1806), reçu maître en 1768, ébéniste ordinaire du roi en 1774.
Traces d’estampille J. H. RIESENER à deux reprises sur l’une des encoignures. Fer du Garde Meuble de la reine et fer CT timbré d’une couronne royale pour le Petit Trianon, marque peinte à l’encre noire du N°. 86. 2 sur les deux.
Ornementations, entrées de serrure et athénienne en argent doré 1er titre 950 millièmes rapportés.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 54,5 cm - Profondeur : 38 cm
Provenance :
Garde Meuble de la reine Marie-Antoinette.
Petit Trianon.
De forme triangulaire à pans coupés en section, formant ressauts pour les montants disposés dans leurs extrémités, ces encoignures en acajou ouvrent par un tiroir en ceinture et par un vantail en façade, les deux à encadrements moulurés formant une légère avancée. La ceinture ainsi que la base sont soulignées par une baguette et un listel en encorbellement. Elles reposent sur des pieds droits réunis par des consoles réunies par consoles en arc de cercle à la traverse frontale de la base. Les vantaux sont ornés en leur centre d’une importante applique de bronze doré au mat représentant une cassolette flammée, montée sur un trépied à jarrets feuillagés et griffes de lion, qui soutiennent une vasque à cul-de-lampe en forme de fleuron pendant avec des feuilles et graines d’acanthe, décorée de registres de cannelures formant un motif étoilé à la base, une bande striée sous la gorge et des cannelures torsadées sur le col mouluré. Les vases à fonds ondés sont munis de deux anneaux sur les côtés et reposent sur une plinthe rectangulaire. Les tiroirs présentent des entrées de serrure en forme de médaillons circulaires entourés de chutes de lauriers et soutenus par des nœuds de rubans. Chaque encoignure est coiffée d’un plateau en marbre blanc veiné dont le pourtour est mouluré en cavet.
Cette paire d’encoignures faisait partie de l’ameublement du Petit Trianon, comme l’attestent les marques de cette résidence présentes sur chacun de nos meubles. Ils portent aussi les fers du Garde Meuble privé de la reine Marie-Antoinette et un numéro d’inventaire peint à l’encre noire de cette administration dont les archives ne nous sont pas, hélas, parvenues. Ainsi, les commandes privées de la reine pour le Petit Trianon n’étaient pas enregistrées dans le Journal du Garde Meuble de la Couronne. Cependant, Riesener, qui apposa son estampille sur l’une de nos encoignures, avait exécuté dès les années 1779 des meubles semblables en acajou, comme l’atteste ce même Journal : ainsi, le 10 juin 1779, il livra trois encoignures en acajou avec leur dessus de marbre Sainte Anne, « ayant portes et tiroirs fermant à clef avec entrées de serrures et anneaux de bronze ciselé doré d’or moulu » pour le salon de Mesdames Tantes du roi à Montreuil, qui furent enregistrées sous le numéro 2998. Plus tard, le 23 novembre 1784, il fournit pour le service de la Reine aux Tuileries « six encoignures de bois d’acajou ayant 15 pouces d’équerre sur 32 pouces de haut, composées de deux tablettes, l’extérieur en bois d’acajou formant pilastre sur les deux côtés, les panneaux entourés de moulures, l’intérieur mis en couleur d’acajou », avec les marbres blanc veiné, qui furent enregistrés dans le Journal sans numéro d’entrée. Par ailleurs, deux de ces encoignures furent identifiées par Pierre Verlet, qui retrouva leur affectation pour la garde-robe des petits appartements de la reine, aux Tuileries, ainsi que le mémoire de Riesener. Bien que dépourvues de tiroirs et sans porte en façade, leur composition du bâti et des montants n’est pas sans rappeler notre paire d’encoignures.
Le Registre de distributions de meubles dans les Maisons royales fait état, lui aussi, le 14 juin 1786, de « 4 Encoignures en bois d’acajou à dessus de marbre blanc », reçues par le Contrôle Général, elles non plus sans numéro du Garde Meuble de la Couronne et vraisemblablement exécutées par le même ébéniste.
Plusieurs meubles provenant du Petit Trianon et portant des marques similaires sont conservés, dont un bureau plat dans les collections du musée J. P. Getty, une petite table à écrire à Waddesdon Manor, une autre passée en vente, les trois par Riesener, une petite commode portant l’estampille de Deloose, sous-traitée par le même Riesener, une table de nuit d’aspect Louis XV, estampillée par Peridiez et livrée probablement en 1768 par Joubert, enfin une seconde, portant le n°17 du Garde Meuble de la Reine, etc.
1. Arch. nat., O1* 3320, f°39.
2. Pierre Verlet, Le mobilier royal français, t. IV Meubles de la couronne conservés en Europe et aux Etats-Unis, Paris, Picard, 1990, n°27 ? P ;105-106.
3. Arch. nat., O1* 3320, f°39.
4. Inv. 71.DA.102.
5. Inv. 2546, voir Geoffrey de Bellaigue, Anthony Blunt, Furniture Clocks and Gilt Bronzes: The James A de Rothschild Collection at Waddesdon Manor, Fribourg, Office du Livre, 1974, vol II, cat. n°106, p. 520-527.
6. Paris, Drouot, Mes Beaussant-Lefèvre, 28 juin 2000, n°161.
7. Vente, Paris, George V, Mes Ader-Picard-Tajan, 15 avril 1989, n°150.
8. Sotheby’s, Londres, 7 décembre 2000, n°96.
9. Sotheby’s, Monaco, 23 juin 1985, n°770.
20 000 € - 30 000 €